n° 64 -2024
La formation continue saisie par le droit
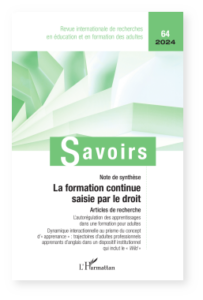 Éditorial
Éditorial
Damien Brochier
Note de synthèse
Pascal Caillaud, Jean-Marie Luttringer, La formation continue
saisie par le droit
Articles de recherche – Research papers
Marine Roche, Hugues Pentecouteau, Jérôme Eneau, Geneviève Lameul, Éric Bertrand, L’autorégulation des apprentissages dans une formation pour adultes
Caroline Fairet, Muriel Grosbois, Dynamique interactionnelle au prisme du concept d’« apprenance » : trajectoires d’adultes professionnels apprenants d’anglais dans un dispositif institutionnel qui inclut le « Wild ».
Comptes rendus de lecture
Danvers, F. S’orienter dans la vie : quel accompagnement à l’ère des transitions ? Pour des sciences pédagogiques de l’orientation. Lille : Presses universitaires du Septentrion, 5 tomes, 2660 p. [ Jean-Pierre Boutinet]
_______________________________
Éditorial
Comme en témoignent notamment les nombreux articles parus dans la revue Savoirs depuis 20 ans (voir le numéro 61-62), la formation des adultes constitue un champ de recherches particulièrement fécond dans les sciences humaines et sociales. Si celui-ci a été largement investi par des chercheurs en sciences de l’éducation, en sociologie ou en économie, il est également l’objet d’une attention particulière dans le monde du droit.
Cet intérêt des juristes pour la formation des adultes découle largement de la haute fréquence des réformes qui ont fait évoluer le système de formation des adultes ces cinquante dernières années, depuis le texte « portant organisation de la formation professionnelle dans le cadre de l’éducation permanente » du 16 juillet 1971, souvent qualifié de « fondateur », jusqu’à la récente loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018. La formation des adultes constitue ainsi un objet juridique parfaitement identifié, qui fait l’objet d’analyses régulières et approfondies de la part d’une communauté active de juristes, notamment dans la revue Droit social. Sans parler d’une véritable dichotomie entre l’approche juridique de la formation des adultes et l’étude de ses dimensions pédagogiques, sociologiques ou économiques, force est cependant de constater que le droit constitue encore un univers singulier, peu mobilisé par les autres disciplines.
Le pari de la note de synthèse proposé dans le présent numéro est précisément de montrer que la compréhension du socle juridique de la formation pour adultes et l’analyse de ses multiples évolutions depuis un demi-siècle représentent des apports essentiels pour mieux analyser la dynamique globale et multiforme du système français de formation pour adultes.
Pascal Caillaud et Jean-Marie Luttringer représentent à cet égard des auteurs particulièrement adaptés à cet exercice, compte tenu de leur volonté constante de faire de la pédagogie du droit de la formation des adultes. Leur texte permet d’abord de comprendre que la formation pour adultes n’est pas cantonnée au seul droit du travail mais s’ancre dans plusieurs branches du droit, notamment le droit international (à travers des conventions ratifiées par la France) ou le droit de la consommation (pour ce qui concerne les contrats de formation passés avec des organismes de formation).
Il montre également que la notion de formation continue, loin d’être immuable, est au contraire « le produit d’une histoire juridique progressive » qui s’ancre dans une histoire longue qui commence dès la Révolution française et s’épanouit avec la loi de 1971, pour connaître ensuite de multiples déclinaisons. Sont bien identifiés deux moteurs centraux de cette transformation des règles juridiques en matière de formation d’adultes.
Le premier, que résume le qualificatif de « loi négociée », tient à la place particulière occupée par les partenaires sociaux. Celle-ci repose sur un processus qui fait systématiquement précéder le vote de chaque loi sur la formation pour adultes de l’élaboration et de la signature d’un accord national interprofessionnel (ANI) entre partenaires sociaux. Le deuxième moteur est constitué par le rôle important des juges qui, à travers la jurisprudence, contribuent à apporter des précisions ou définir des limites dans le domaine de la formation des adultes.
Enfin, au moment où le développement du Compte Personnel de Formation (CPF) rebat les cartes en matière d’accès des adultes à la formation en promouvant leur « liberté de choisir [leur] avenir professionnel », la note éclaire d’un point de vue juridique les enjeux et l’exercice de cette liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les individus. La lecture de cette note de synthèse constitue au final un détour intellectuel salutaire et indispensable pour baliser de manière efficace les recherches et analyses pédagogiques, sociologiques ou économiques sur la formation d’adultes, en rappelant que celle-ci est « à la fois un acte de liberté, une source de responsabilité et un objet de garanties collectives et sociales ».
Damien Brochier
__________________________________________
Communications de recherche
résumés
____________________________
Pascal Caillaud,
Chargé de recherche au CNRS en Droit social, Laboratoire « Droit et Changement social » (UMR 6297 CNRS) – Université de Nantes Directeur du Centre associé au Céreq de Nantes
Jean-Marie Luttringer
Ancien Professeur associé à l’Université Paris Nanterre, Expert en droit et politiques de formation
Note de synthèse : La formation continue saisie par le droit
Comme tout corpus juridique, le droit de la formation professionnelle continue se caractérise par des normes, des institutions, des prérogatives et des obligations particulières, fruits d’une évolution historique donnée. La formation continue obéit ainsi à un régime juridique aux sources éclatées, donnant une place singulière aux partenaires sociaux, tout en étant soumis au pouvoir créateur des juges. Saisie par la législation comme un objet juridique particulier, elle s’accompagne d’un droit à l’information, au conseil et à l’orientation professionnelle pour le bénéficiaire, en activité comme en recherche d’emploi. Son accès dans l’entreprise s’organise entre libertés et obligations pour l’employeur et le salarié, dans un écosystème institutionnel soumis aux enjeux de financement. Enfin, sa reconnaissance soulève des problématiques de certifications, de classifications et de qualification professionnelles, au cœur des relations professionnelles. À l’aube d’une nouvelle réforme annoncée, les mutations contemporaines de la société conduiront inévitablement à une nouvelle adaptation de ce droit. Acte de liberté, source de responsabilité, objet de garanties collectives et sociales, la formation professionnelle n’a pas fini d’être « saisie » par le droit.
Mots-clés : formation professionnelle, formation tout au long de la vie, partenaires sociaux, droit du travail, négociation collective, compte personnel de formation, certifications professionnelles, qualifications, organismes de formation
Vocational training within the framework of the law
Like any legal corpus, the vocational training law is characterized by specific standards, institutions, prerogatives and obligations, fruit of a given historical development. Vocational training is governed by a legal system with fragmented sources, giving a singular place to social partners, while at the same time being subject to the creative power of judges. Seized by legislation as a specific legal object, it’s accompanied by a right to information, advice and professional guidance for the beneficiary, whether in employment or unemployed. Access to it in firms is organized between freedoms and obligations for both employer and employee, in an institutional ecosystem subject to funding issues. Finally, its recognition raises issues of professional certifications, classifications and qualifications, at the heart of industrial relations. Before a new announced reform, society changes will inevitably lead to a new adaptation of this law. As an act of freedom, a source of responsibility and an object of collective and social guarantees, vocational training will continue to be “seized” by the law.
Keywords: vocational training, lifelong learning, social partners, labor law, collective bargaining, personal training account, professional certifica- tions, qualifications, training bodies
__________________________________________
Communications de recherche
résumés
__________________________________________
Marine Roche
Ingénieure de recherche en sciences de l’éducation et de la formation, CREAD, Université Rennes 2
Hugues Pentecouteau
Professeur des Universités en sciences de l’éducation
et de la formation, Université Rennes 2, CREAD
Jérôme Eneau
Professeur des Universités, Université Rennes 2
Geneviève Lameul
Professeure des Universités en sciences de l’éducation et de la formation, Université Rennes 2
Éric Bertrand
Maître de conférences en sciences de l’éducation et de la formation, Université Rennes 2
L’autorégulation des apprentissages dans une formation pour adultes : L’exemple de la demande d’aide et l’utilisation d’une plateforme d’apprentissage en ligne
Cet article présente une étude empirique sur les stratégies d’autorégulation dans le cas d’une formation pour adultes. Il s’agit plus particulièrement d’interroger les deux stratégies d’apprentissage que sont les seeking information et seeking social assistance (Zimmerman et Pons, 1986). L’objectif est d’identifier et de décrire les pratiques de demande d’aide des apprenants durant l’utilisation de formation en ligne. Le terrain de la recherche est une formation destinée aux adultes et vise une insertion professionnelle dans le domaine du numérique. À partir de 23 entretiens semi-directifs recueillis auprès des stagiaires de la formation, l’analyse souligne une diversité des pratiques de demande d’aide. Les résultats montrent l’existence de règles de préférence des stagiaires pour déterminer la source d’aide la plus adaptée à leur besoin selon le contexte de la demande d’aide.
Mots-clés : formation en ligne, autorégulation, demande d’aide, formation d’adultes
Self-regulated learning among adult learners. Drawing on examples of help-seeking during e-learning training sessions
This article presents an empirical study that focuses on adult learners’self-regulatory strategies. Specifically, it questions two learning strategies, i.e., “seeking information” and “seeking social assistance” (Zimmermanand Pons, 1986). It seeks to identify and describe how learners seek helpduring online training sessions. The study is based on an adult trainingprogram aimed at professional integration into the digital field. Drawingon 23 semi-structured interviews collected from learners, the findingshighlight the diverse ways in which these learners request for help. Theresults show that these learners are guided by specific rules which they useto determine the source of aid best suited to their needs according to thecontext in which this help is sought.
Keywords: online training, self-regulated learning, help seeking, adulttraining
_______________________________
Caroline Fairet
Doctorante en Humanités nouvelles, spécialité apprentissage
des langues, Laboratoire FoAP, CNAM
Muriel Grosbois
Professeur des Universités en anglais, Laboratoire FoAP, CNAM, EA7529
Dynamique interactionnelle au prisme du concept d’« apprenance » : trajectoires d’adultes professionnels apprenants d’anglais dans un dispositif institutionnel qui inclut le « Wild »
Notre étude longitudinale pilote vise à identifier et comprendre les trajectoires d’apprentissage de l’anglais par des adultes professionnels dans un dispositif hybride qui articule un environnement institutionnel avec les contextes d’usage et d’apprentissage en dehors de la classe ou « Wild ». Ces trajectoires sont explorées sous l’angle de la dynamique interactionnelle au prisme du concept d’«apprenance» (Carré, 2005). Une analyse qualitative et quantitative des données a été conduite sur la base de questionnaires, journaux de bord, récits d’apprentissage et entretiens semi-directifs. Les résultats permettent d’identifier les effets de la dynamique dans le temps en termes d’apprentissage de la langue et de dispositions à apprendre. Ils montrent comment le concept d’« apprenance » peut-être envisagé à la fois comme un cadre épistémologique, un outil d’analyse et un support à la conception de dispositifs d’apprentissage favorisant le développement de dispositions à apprendre tout au long de la vie.
Mots-clés : apprenance, apprentissage des langues, environnements d’apprentissage, apprentissage tout au long de la vie
Interactional dynamics in light of the concept of “apprenance”: the trajectories of adult learners of English in a blended learning environment combining an institutional setting and opportunities in the “Wild”
This longitudinal pilot research aims to identify and understand the trajectories of adult learners of English in a blended learning environment which interfaces an institutional context with the opportunities to use and learn English in the “Wild”. Their trajectories are explored from the interactional dynamics perspective in light of the concept of “apprenance” (Carré, 2005). A qualitative and quantitative approach was conducted using questionnaires, logbooks, learning narratives, and semi-structured interviews. The results allow us to identify the effects of the dynamics over time in terms of L2 learning and dispositions to learn. They also unveil how the concept of “apprenance” can be conceived as an epistemological framework, an analytical tool and a support for the design of institutional learning environments that promote lifelong learning dispositions.
Keywords: apprenance, language learning, learning environments, life-long learning
_______________________________
n° 65 -2024
Les dynamiques temporelles en formation
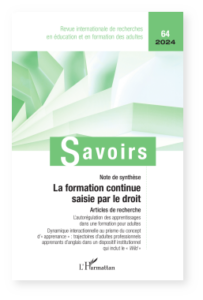 Éditorial
Éditorial
Véronique Tiberghien
Note de synthèse
Pascal Roquet, Jean-Pierre Boutinet, Les dynamiques temporelles
présentes dans les formations tout au long de la vie
Articles de recherche – Research papers
Pauline Born, Une approche genrée de sélection au cours des premières années d’engagement chez les sapeurs-pompiers volontaires.
Vie de la recherche
Christophe Jeunesse, Dina A Dinda, Olivier Las Vergnas, Recherches doctorales et HDR intéressant la formation des adultes soutenues en France de 2020 à 2023 et accessibles en ligne sur HAL.
Comptes rendus de lecture
Heslon, C. (2021). Psychologie des âges de la vie adulte. Vie plurielle et quête de soi. Paris : Dunod, 245 p. [Philippe Carré]
Granjon, F. (2022). Classes populaires et usages de l’informatique connectée : des inégalités sociales-numériques, Paris, Presses des Mines, 360 p.
[Marie Buscatto]
Verrier, C. (2023). Regards actuels sur l’autodidaxie et les autodidactes. Paris : Petra, 261 p. [Gaston Pineau]
Lucie Mottier Lopez, Hommage à Pierre Dominicé.
_______________________________
Éditorial
Les Sciences Humaines et Sociales se sont intéressées depuis longtemps à la question des temporalités pour étudier à la fois la perception humaine du temps et son organisation sociale. Les recherches concernent les rapports des sociétés au temps et la production sociale des temporalités, les représentations du temps des individus ou groupes d’individus, les tensions entre le temps imposé et institué et le temps vécu et subjectivé, l’articulation des différentes échelles du temps, etc.1 . Selon l’angle disciplinaire de référence (philosophie, sociologie, psychologie sociale…), les temporalités revêtent des caractéristiques spécifiques renvoyant aux aspects pluriels de cette question du temps. C’est aux temporalités éducatives et formatives qu’est consacrée la note de synthèse présentée dans le présent numéro. Pascal Roquet et Jean Pierre Boutinet proposent une réflexion sur les dynamiques temporelles qui sous-tendent la rénovation de la formation tout au long de la vie de ces dix dernières années en mettant en perspective la littérature produite sur ces questions. Ces dynamiques temporelles s’avèrent reliées aux environnements sociaux et économiques actuels marqués par la mobilité, le changement incessant, l’immédiateté et la flexibilité. Mais en même temps elles s’inscrivent dans le vécu propre à chaque individu, dans son rapport au temps et dans ses croyances. Au cœur de l’analyse émerge la notion de « temps paradoxal ». D’emblée, les auteurs mettent en évidence deux « façons de problématiser le temps en éducation et formation » (p. 4) et opposent les travaux de deux pionniers de la recherche sur le temps en formation d’adultes, Jacques Ardoino et Gaston Pineau. Le premier, inspiré par Henri Bergson, met l’accent sur la durée créatrice, le mouvement et le cheminement individuel qui caractérisent les temps humains et qui s’opposent au temps rationnel et institutionnel des systèmes scolaires et de formation. Le second, puisant dans la pensée de Gaston Bachelard, propose un modèle complexe et dialectique faisant alterner un temps de formation expérientielle et un temps de formation formelle instituée, permettant alors de juxtaposer la formation de soi par soi, la formation par l’autre et la formation par les environnements et les situations. On reconnaît là les apports fondamentaux de Gaston Pineau à la compréhension de ce qu’est l’autoformation.
Ces oppositions servent de fil conducteur à la présentation des évolutions de la formation d’adultes de ces dernières années. Pour les auteurs, toute mise en œuvre d’un programme de formation implique une cohabitation, parfois fragile, entre des temporalités paradoxales : un passé lié au programme de formation préalablement conçu et institutionnalisé, le présent de la négociation du projet de formation et de la mise en œuvre de l’action et enfin l’avenir envisagé sous l’angle des retombées futures. C’est à l’aune de cette question des temporalités paradoxales que les auteurs passent en revue sept figures dominantes de la formation tout au long de la vie marquant le début du 21e siècle, en se référant aux principaux auteurs s’intéressant à la question du temps. Sont ainsi mises en évidence la temporalité duale de l’alternance prenant la forme d’une confrontation entre le temps de l’expérience professionnelle et celui de la mise à distance de cette expérience ou encore celle de l’accompagnement (coaching, tutorat, mentorat…) mettant en tension la posture relationnelle présentiste et la posture projective tournée vers un but commun aux partenaires impliqués. De la même façon, les Actions de Formation en Situation de Travail (Afest), plus récentes, se déroulent selon plusieurs étapes entrecroisant une pluralité de rapports au temps. Quant à la Formation à Distance (Foad), elle se base sur une hybridation présence/ absence, porteuse d’autonomie et de liberté pour les apprenants. La note de synthèse permet de relier des travaux aux références disciplinaires variées, mais partageant le même intérêt pour les rapports sociaux et individuels au temps en formation d’adultes. Les auteurs concluent leur ana- lyse en soulignant le passage récent dans les sciences humaines et sociales de la notion de trajectoire à celle de parcours de vie. Ce changement de paradigme renvoie à une reconfiguration des rapports au temps, davantage reliés à l’agentivité des acteurs et à leur autonomisation.
Le texte de P. Roquet et J.-P. Boutinet est suivi d’un article de Pauline Born consacré à la formation de base s’adressant à des sapeurs-pompiers volontaires. À partir de données qualitatives, l’auteure analyse les obstacles spécifiques rencontrés par les femmes durant leur parcours et met en évidence les freins liés au genre impactant l’engagement dans l’activité et la construction de l’identité professionnelle.
La rubrique « Vie de la recherche » s’enrichit d’une dixième contribution, rédigée par C. Jeunesse, D. Adinda et O. Las Vergnas. Elle complète les contributions précédentes concernant la production des thèses sur la formation d’adultes. Les auteurs se sont intéressés cette fois-ci aux thèses et HDR soutenues en France entre 2020 et 2023 et ont exploité les documents déposés pour cette période dans l’auto-archive ouverte HAL.
Trois comptes rendus de lecture viennent clore ce numéro 65.
Véronique Tiberghien
__________________________________________
Note de synthèse
résumé
__________________________________________
Pascal Roquet
Foap, Conservatoire National des Arts et Métiers
Jean-Pierre Boutinet
Professeur émérite, Université Catholique de l’Ouest à Angers
Note de synthèse : Les dynamiques temporelles présentes dans les formations tout au long de la vie
Résumé
La variété actuelle des actions de formation entrant dans le dispositif de la formation tout au long de la vie sollicite une réflexion sociétale sur les différentes dynamiques temporelles qui les sous-tendent et leur donnent sens. Ces dynamiques en effet dans leur diversité mais aussi leur singularité constituent l’un des paramètres essentiels pour déterminer la pertinence d’une formation et sa capacité à coopérer avec les temporalités ambiantes.
En partant des problématiques temporelles de deux pionniers marquants en sciences de l’éducation et de la formation, Ardoino et Pineau, deux façons de problématiser le temps en formation ont été identifiées qui toutes les deux mettent en évidence des temporalités paradoxales à faire cohabiter.
Ce sont sept figures typiques de ces temporalités paradoxales qui ont pu être relevées dans la littérature scientifique, principalement francophone, qui sont mises en évidence dans la suite de la Note de synthèse, ouvrant sur des perspectives pour des cheminements pluriels dans les démarches de formation et d’apprenance adultes.
Mots-clés : dynamiques temporelles, temporalités paradoxales, formation et temporalités, formations tout au long de la vie
Temporal dynamics of the lifelong learning system
The current variety of adult training actions being part of the lifelong learning system requires societal reflection on the different temporal dynamics that underlie them and give them meaning. These dynamics in their diversity but also their singularity constitute one of the essential parameters for determining the relevance of a training course and its capacity to cooperate with the ambient temporalities. Starting from the temporal issues of two notable pioneers in the sciences of education and training, J. Ardoino and G. Pineau, two ways of problematizing time in training have been identified
which both highlight paradoxical temporalities that need to cohabit. There are seven typical figures of these paradoxical temporalities which have been noted in the scientific literature, mainly French speaking, highlighted in the rest of the review, opening on perspectives for plural paths in the training approaches and of adult learning.
Keywords : temporal dynamics, paradoxical temporalities, training and temporalities, lifelong learning
__________________________________________
Communications de recherche
résumés
____________________________
Pauline Born
Docteure en sciences de l’éducation et de la formation, IREDU, Université de Bourgogne
Une approche genrée de sélection au cours des premières années d’engagement chez les sapeurs-pompiers volontaires
Résumé
Cet article s’intéresse à l’intégration des femmes chez les sapeurs-pompiers volontaires. S’appuyant sur un cadrage théorique consacré à l’engagement et à l’identité professionnelle, il se concentre sur les premières années d’engagement, dédiées essentiellement au suivi de la formation initiale obligatoire. À partir d’une méthodologie qualitative, l’article propose une analyse des obstacles rencontrés par les femmes au début de leur parcours de sapeur-pompier volontaire, au cours de leur formation initiale et dans la vie à la caserne. Les résultats montrent que les difficultés auxquelles elles font face ont un impact sur leur développement identitaire et la poursuite de leur engagement. Le milieu semble toujours souffrir d’une approche genrée de sélection.
Mots-clés : sapeur-pompier volontaire, formation, engagement, identité professionnelle
A gendered approach to selection during the first years of volunteer firefighter service
This article looks at the integration of women into the volunteer fire service. Based on a theoretical framework devoted to commitment and professional identity, it focuses on the first few years of commitment, essentially devoted to completing the compulsory initial training. Using a qualitative methodology, the article analyses the obstacles encountered by women at the start of their career as volunteer fire fighters, during their initial training and in their life at the fire station. The results show that the difficulties they face have an impact on the development of their identity and the continuation of their contract. The field still seems to suffer from a gendered approach to selection.
Keywords: volunteer firefighter, training, commitment, professional identityg
__________________________________________
Vie de la recherche résumés
__________________________________________
Christophe Jeunesse
Équipe Cref-ApForD, Université Paris-Nanterre
Dina Adinda
Équipe Cref-ApForD, Université Paris-Nanterre
Olivier Las Vergnas
Équipe Cref-ApForD, Université Paris-Nanterre ; équipe Cirel-Trigone, Université de Lille
Recherches doctorales et HDR intéressant la formation des adultes soutenues en France de 2020 à 2023 et accessibles en ligne sur HAL
Résumé
Cet article analyse les thèses de doctorat et les mémoires d’habilitation à diriger des recherches (HDR) portant sur la formation des adultes, soutenus en France entre 2020 et 2023. Dans une logique de science ouverte, les auteurs se sont concentrés sur les documents déposés pour cette période dans l’auto-archive ouverte HAL. Selon les principes mis au point dans les articles précédents de cette rubrique, ils ont recherché la présence de termes clés (caractéristiques de la formation des adultes) respectivement dans les titres ou dans les résumés. Ont été ainsi identifiés un « noyau dur » de 85 thèses et 5 HDR, et un « second cercle » de 93 autres thèses et 5 autres HDR. Les lexiques repérés dans le corpus retenu sont peu différents de ceux trouvés sur la période précédente, malgré quelques variations notables, comme le renforcement de certaines classes de lexiques ou ceux concernant la « didactique professionnelle » et la « qualification emploi et conseil ». On peut imaginer que leurs montées en puissance ne sont pas sans rapport avec des questionnements liés à la loi de 2018 et à une certaine croissance de la formalisation par les référentiels de compétences.
En revanche, aucun impact direct de la Covid-19 n’a été détecté, très probablement en raison de la proximité temporelle de la période étudiée avec l’épidémie. Des comparaisons plus approfondies sont prévues dans le prochain article de la rubrique.
Mots-clés : formation des adultes, thèses de doctorat, didactique professionnelle, qualification emploi, bibliométrie
Doctoral and HDR research relevant to adult education in France from 2020 to 2023
This article analyzes doctoral theses and accreditation to supervise research (HDR) dissertations focusing on adult education, defended in France
between 2020 and 2023. Embracing the principles of open science, the authors concentrated on documents submitted during this period in the open self-archive HAL. Following the methodology developed in previous articles of this series, they searched for the presence of key terms (characteristics of adult education) in the titles or abstracts. Consequently, a “core group” of 85 theses and 5 HDRs, and a “second circle” of 93 other theses and 5 more HDRs were identified. The themes identified in the obtained corpus show little difference from those found in the previous period, despite some notable variations such as the strengthening of lexicons related to “professional didactics” and “employment qualification and counselling”. The increasing prominence of these lexicons likely relates to issues connected to the 2018 law and a rise in formalization through competency frameworks.
However, no direct impact of Covid-19 has been detected, most likely due to the temporal proximity of the studied period to the epidemic. More detailed comparisons are planned in the next article of the series.
Keywords: adult education, doctoral theses, occupational didactics, employment qualification, bibliometrics
n° 66
